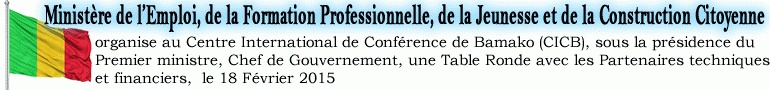Ibrahim Ag Bahanga menait depuis sept mois une rébellion qui risquait d’embraser toute la région. Le 13 février, un accord a été trouvé avec les autorités de Bamako.
Le 24 février, un avion militaire venant de Kidal, dans le Nord-Mali, se pose sur le tarmac de l’aéroport de Bamako. Dix hommes épuisés en descendent. Ils sont accompagnés d’Ibrahima Samba Touré, dit Archie, conseiller du président Alpha Oumar Konaré, et d’Abdelkrim Gheraïeb, ambassadeur d’Algérie à Bamako. Ce sont dix militaires, dont deux officiers, pris en otages en décembre 2000 par un groupe touareg rebelle dirigé par Ibrahim Ag Bahanga. Cette libération est le dénouement heureux d’une crise aux conséquences imprévisibles pour la stabilité de la région.
Retour en arrière. En mars 1996, à Tombouctou, le président Konaré met symboliquement le feu à un amas d’armes déposées par les rebelles touaregs. Cette cérémonie, baptisée « Flamme de la paix », constitue l’aboutissement des accords, parrainés par l’Algérie, entre le gouvernement malien et l’Azawad, un mouvement éclaté en plusieurs tendances, mais qu’incarnait Iyad Ag Ghali, chef incontesté du Mouvement populaire de l’Azawad (MPA).
Ce jour-là, un cadre du MPA, Ibrahim Ag Bahanga, assiste, sceptique, à la cérémonie. Il fait partie de ceux qui sont appelés à devenir sous-officiers de l’armée malienne. Il ne fait aucune confiance aux politiques mais continue d’obéir à ses chefs. À contre coeur.
Pour l’heure, les anciens seigneurs de guerre, devenus des notabilités, accèdent à des crédits pour se lancer dans les affaires. Zeidane Ag Sidalamine, secrétaire général du Front populaire de libération de l’Azawad (FPLA), obtient un poste de conseiller à Koulouba, siège de la présidence de la République. De nombreux dirigeants rebelles entrent dans l’administration et la diplomatie. Dans le domaine du développement, le Nord absorbe plus de la moitié de l’aide extérieure… sans que la population n’en bénéficie pour autant. Les fonds sont le plus souvent détournés, et les secteurs de l’éducation et de la santé sont toujours dans un état déplorable.
Ibrahim Ag Bahanga dénonce le non-respect par Bamako de ses engagements. Mais un militaire doit se taire, ou déserter. Il quitte l’armée en 1998. Quelques mois plus tard, le gouvernement, dirigé alors par Ibrahim Boubakar Keïta (IBK), décide d’un nouveau découpage territorial. La région d’In Tejdit, où vit la tribu des Bahanga, est coupée en deux entre la commune de Kidal et celle de Menaka. La fronde d’Ibrahim se fait de plus en plus bruyante. Les rapports de la Sécurité d’État, dirigée par Soumailou Boubeye Maïga, font état d’une activité subversive croissante de sa part. Ibrahim se déplace à travers le désert, de l’Aïr au Niger, où il compte de nombreuses tribus sympathisantes, et en Mauritanie. Désormais en situation de désobéissance civile, il se prépare à la lutte armée.
Prenant conscience du danger, IBK dépêche son ministre de la Sécurité, Sada Samake, auprès d’Ibrahim Ag Bahanga. Celui-ci lui dresse alors une liste de griefs : les populations effectuent des centaines de kilomètres pour obtenir le moindre papier administratif, il n’y a pas eu une seule ouverture de classe depuis la cérémonie de la Flamme de la paix. Enfin, les combattants de l’Azawad intégrés dans l’armée sont marginalisés. Le ministre promet de programmer, à l’Assemblée, une révision du découpage territorial. De son côté, Ibrahim Ag Bahanga s’engage à surseoir à la lutte armée. Le temps passe, le gouvernement malien a d’autres priorités. Ibrahim a gelé son activité militaire, mais sans y renoncer définitivement. Il sillonne toujours les trois pays : Niger, Mali et Mauritanie.
En janvier 2000, en Mauritanie, des concurrents du rallye Paris-Dakar sont attaqués par un groupe armé. Les services de sécurité locaux lancent un vaste coup de filet. Ibrahim Ag Bahanga est interpellé. Mais les Mauritaniens n’ont rien à lui reprocher. Faute d’une demande d’extradition, ils le relâchent trois mois plus tard.
Durant sa captivité, Ibrahim Ag Bahanga apprend le limogeage d’IBK. Sa méfiance à l’égard des promesses de Bamako était donc fondée. Il décide de passer à la lutte armée. À la tête d’un petit groupe, il s’attaque, en août 2000, à une position avancée de l’armée malienne. Il dévalise le magasin d’armement, récupère les moyens de transmission et deux véhicules tout-terrain, puis propose aux militaires touaregs de le rejoindre. Bahanga devient le maître du désert.
Le témoignage d’un chercheur allemand qui l’a croisé le confirme : « Au-delà de Kidal, et jusqu’à la frontière algérienne, il n’y a plus d’État. La protection de Bahanga est nécessaire. » Le rebelle en profite- t-il ? Difficile à dire, car on ne signale aucune razzia de la part de ses hommes. « Mon combat est politique, assure-t-il. Les seuls véhicules dont nous disposons ont été pris à l’ennemi. » L’ennemi ? L’armée malienne, passée sous les ordres de Boubeye Maïga, devenu ministre des Forces armées dans le gouvernement de Mandé Sidibé. Pour l’ancien patron des services maliens, il s’agit d’un problème transnational : « Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit du contrôle de la route de tous les trafics. Armes, cigarettes et véhicules volés en Europe. C’est un marché de plusieurs milliards de francs CFA. Qui contrôle cet axe routier est assuré d’une importante rente. »
À Bamako, deux thèses s’affrontent : liquider militairement Bahanga ou le neutraliser politiquement. C’est finalement l’option des colonels qui l’emporte. Les ratissages se multiplient, mais tournent au fiasco. Au renforcement de la pression militaire, les hommes de Bahanga répliquent par une série d’attaques.
En décembre 2000, ils assiègent une caserne, au nord de Kidal, tuent un garde, en blessent deux autres et prennent en otages deux officiers et huit soldats. Quelques jours plus tard, ils s’en prennent à une caravane médicale qui se déplace dans le Nord dans le cadre d’une campagne de vaccination. Désormais, Bahanga constitue une sérieuse menace. Niamey craint la contagion, Nouakchott est sur ses gardes et le Burkina, déjà préoccupé par les événements de Côte d’Ivoire, redoute le réveil de l’irrédentisme touareg.
Le président Konaré, qui n’a jamais été convaincu par l’option militaire, est plus que contrarié. Accaparé par ses mandats internationaux – présidence en exercice de la Cedeao, de l’Uemoa et du Conseil de sécurité -, il tient à quitter la scène politique (son deuxième et dernier mandat s’achève en juin 2002) en laissant un pays stable. Il téléphone à son ami Eglézé Ag Foni, gouverneur de Kidal, et le charge de trouver un médiateur crédible. Ce sera Iyad Ag Ghali. L’ancien chef du MPA, reconverti dans le négoce international, accepte.
En janvier 2001, alors qu’il se rend dans le fief des insurgés, Iyad Ag Ghali est discrètement suivi par des militaires. S’ensuit un accrochage avec une colonne rebelle. L’opération fait une seule victime : la tentative de médiation. Le président Konaré prend alors les choses en main. Il convoque deux officiers supérieurs : le général Tiekoura Doumbia, ministre de la Sécurité, et le colonel Brehima Coulibaly, son chef d’état-major particulier. Le général Doumbia, ancien patron de la Sécurité d’État sous Moussa Traoré et ex-gouverneur de Kidal, connaît parfaitement le dossier.
Quant au colonel Coulibaly, il jouit de l’entière confiance du président. Les deux hommes se rendent à Kidal pour sauver ce qui peut l’être encore. Ils rencontrent un Iyad Ag Ghali hors de lui : « En me suivant, vous m’avez fait passer pour un traître. Je ne peux plus rien pour vous. » Le général Doumbia tente de le raisonner : « Il s’est agi d’une initiative prise à un niveau subalterne. Notre présence ici engage le président, vous ne pouvez pas réagir de la sorte. » Iyad exige comme préalable à la reprise de sa mission une caution supplémentaire : la participation d’Abdelkrim Gheraïeb.
Gheraïeb est ambassadeur d’Algérie à Bamako. Il a participé aux côtés d’Ahmed Ouyahia, actuellement ministre de la Justice en Algérie, à la médiation entre le gouvernement malien et le mouvement Azawad. Tous deux avaient parrainé les accords de Tamanrasset en 1992. Gheraïeb est également connu pour avoir été un des négociateurs lors de l’affaires des otages américains en Iran, en 1980. Il était à l’époque ambassadeur d’Algérie à Téhéran.
Koulouba, le 29 janvier. Gheraïeb est convoqué à la présidence. Il accepte de se rendre à Kidal à une condition : en tant qu’observateur et non comme médiateur. Accord de Konaré qui délègue son conseiller politique, Ibrahima Samba Touré, alias Archie, pour négocier avec Bahanga. Le 1er février, un avion militaire dépose les deux hommes à Kidal. Iyad et le gouverneur Eglézé les attendent. Trois véhicules conduits par des hommes d’Iyad les mènent dans les grottes qui servent de quartier général au rebelle touareg.
« Je suis là pour obtenir la libération des détenus », dit en guise d’introduction Gheraïeb. Bahanga se lance dans un long monologue et énonce ses griefs à l’encontre du pouvoir central de Bamako. Après une nuit de discussion, le diplomate et le conseiller du président retournent dans la capitale. L’ambassadeur transmet les doléances des rebelles au chef de l’État : établissement d’une commune administrative à In Tejdit, création d’une agence de développement pour cette région, amnistie pour les membres du groupe. Konaré est soulagé. Ils n’exigent pas de réintégrer l’armée, ce qui aurait été difficile car « ils ont quand même fait couler le sang ! »
Le 13 février, Gheraïeb et Touré repartent à Kidal. Objet de longues discussions, un mémorandum sanctionne cette deuxième rencontre. À propos des détenus, Bahanga veut utiliser la formule « prisonniers de guerre « . » Pas question ! s’exclame Archie. Il s’agit d’otages. » Gheraïeb propose un compromis : libération des détenus. Les pouvoirs publics s’engagent à soumettre à l’ordre du jour de la prochaine session parlementaire l’instauration d’une nouvelle commune à In Tejdit. Konaré signe un décret créant l’Agence de développement intégré du Nord (Adin), et s’engage à ne pas poursuivre pénalement les membres du groupe. Quant à Bahanga, il promet de restituer l’armement et l’équipement dérobés lors des attaques contre l’armée et de cesser toute activité militaire. Le document est signé par le représentant du président, par le gouverneur de Kidal, par Iyad Ag Ghali et par Bahanga.
Restait à organiser la libération des détenus. Bahanga demande un délai de quelques jours pour les réunir, et souhaite les remettre directement à Gheraïeb. Celui-ci refuse au motif qu’il n’est qu’un simple observateur. Bahanga insiste : « Je ne veux pas courir le risque de les remettre à l’armée. Ils sont capables de les éliminer et de me faire porter le chapeau ! » Gheraïeb propose alors qu’ils soient confiés au gouverneur Eglézé, un responsable civil, de surcroît homme de confiance du président. Les discussions prennent fin avec la promesse de Bahanga de libérer les otages le 21 février.
Le 22 février, Konaré est en audience quand Madeira Diallo, son secrétaire particulier, lui passe une communication téléphonique urgente. C’est Gheraïeb. Il vient d’apprendre que les rebelles sont disposés à relâcher leurs otages qui arrivent, finalement, le 24 à Bamako.
MALI – 20 mars 2001 – par CHERIF OUAZANI
LA DESINFORMATION
Le mot «désinformation» n’existe ni dans la langue française ni dans la langue anglaise, et il ne se trouve pas dans le dictionnaire que dans le Code Pénal français.
On est donc en droit de se demander si ce mot a une existence légale, à tout le moins réelle, et s’il peut légitimement être employé pour servir de référence ou de justification aux actes et décisions de la juridiction d’exception qu’est la Cour de Sûreté de l’Etat.
D’autant qu’il apparaît que cette dernière vient tout juste de découvrir une arme pourtant vieille comme le monde, qu’elle n’en connaît pas le maniement et qu’elle hésite encore à la classer comme une arme d’attaque ou comme une arme de défense.
Pour se convaincre que «la désinformation» est une arme vieille comme le monde, il suffit de lire «L’Art de la Guerre» rédigé par un auteur chinois, au Vème siècle avant Jésus Christ, Sun Tzu. On y trouve exposés les définitions, moyens et procédés concernant l’espionnage, la manipulation et la désinformation.
Ce qu’a écrit Sun Tzu a traversé les siècles et est toujours étudié et exploité en Chine. Ainsi, au cours du conflit qui a opposé la Chine populaire de Mao-Tsé-Toung à la Chine nationaliste de Tchang-Kai-Check et, parallèlement à la lutte armée, un combat tout aussi dévastateur a été mené par les deux camps, en fonction d’un argumentaire inspiré de la psychologie des foules.
Les sinologues qui se sont penchés sur cette guerre sont unanimes à le reconnaître et, du même coup, ils expliquent et font mieux comprendre l’élimination, par «disqualification», de Tchang kaï-check. Ce sont des spécialistes, des maîtres-espions de la Chine communiste qui ont formé leurs homologues russes du N.K.G.B. (commissariat du Peuple à la Sécurité d’Etat), fondé en 1941, à la suite d’accords passés entre Staline et Mao Tsé Toung, ce dernier recevant par ailleurs une aide financière, des livraisons de matériels et d’armements fournis par la Russie.
Une réorganisation des services secrets entrepris par Khrouchtchev, en 1954, donne naissance au K.G.B. (Comité de la Sécurité d’Etat) qui reçoit pour tâche principale de développer le département «subvention», en privilégiant la branche «intoxication».
En 1968, le Poliburo décide au sein du K.G.B, la création d’un service spécifique portant la lettre A, et qui est désigné par un nouveau mot russe : «dezinformatsiya». La direction en est d’abord confiée au général Ivanovitch. Agayantz et ensuite à Sergueï Kondrachev.
A l’époque, cela englobe déjà un ensemble de techniques et d’activités appliquées pour faire progresser dans le monde les objectifs de politique étrangère soviétique par le truchement des média, à travers les intellectuels.
Effectivement, parler de désinformation, c’est évoquer la déstabilisation intellectuelle, c’est parler de stratégie et de guerre culturelle à partir d’un postulat ainsi défini par Henri Gobard : «…. La guerre classique vise au cœur pour tuer, la guerre économique vise au ventre pour exploiter et enrichir, la guerre culturelle (ou la désinformation) vise à la tête pour paralyser sans tuer, pour conquérir par le pourrissement, et s’enrichir par la décomposition des cultures et des peuples…»
Cette forme de guerre, essentiellement psychologique, a fait et fait merveille. Aujourd’hui, devant les difficultés (et les dangers) pour les grandes puissances d’engager leurs forces armées à l’extérieur, le recours à la guerre culturelle (ou désinformation) et à la propagande permet un pilonnage ininterrompu, qui ne laisse que peu de loisirs à l’adversaire pour organiser sa résistance ou sa contre-attaque. Mieux, l’adversaire soumis à un tel régime doit tomber comme un fruit mûr. Inutile devient alors la guerre des armes si ce n’est pour quelques coups d’Etat ou interventions limitées qui assurent une victoire largement acquise d’avance.
La désinformation a pour passage obligatoire l’intoxication, qui est répertoriée sous trois formes distinctes :
L’intoxication blanche : Elle consiste à révéler à une opinion publique nationale ou à l’opinion publique internationale des faits réels, mais restés secrets pour diverses raisons ou, simplement, par raison d’Etat.
L’intoxication grise : Elle correspond à un cocktail de vérité, demi- vérités et contre- vérités. Dans la trame des faits vrais, véritables à détecter. Le tout donne une grande impression d’authenticité.
L’intoxication noire : Elle est un produit totalement imaginé, inventé. Cela peut être une information fausse qui sera longue à analyser, ou une campagne malaisée à cerner et apte à provoquer une tension ou un choc.
Ces trois formes d’intoxication peuvent appartenir à deux groupes référencés aussi par deux couleurs : le groupe «bleu», quand il s’agit d’opérations menées par le gouvernement à l’intérieur de ses frontières, le groupe «rouge» quand il s’agit d’opérations menées par le gouvernement à l’extérieur de ses frontières.
A cet endroit de la présente étude, il est important de préciser que si le mot «désinformation» – le contraire du mot «information» – a bien été imaginé par les russes, l’intoxication, avec ses trois formes et ses deux groupes, est une arme employée par toutes les grandes et moyennes puissances qui, par ailleurs, depuis plusieurs décennies, se sont dotées de services et de moyens liés à cette arme.
Cela est vrai pour la France comme pour la Chine, ainsi que nous l’avons vu, le Japon, l’Allemagne, l’Angleterre, les Etats-Unis, etc…. Mais il est sûr que la Russie est à l’avant-garde d’un phénomène qui obéit à l’injonction de Lénine : «…Mes paroles sont choisies pour provoquer aversion, haine et mépris de l’adversaire, disloquer ses rangs, le détruire, balayer ses structures de la surface du monde…», mobilisant des partis communistes qui jouent un rôle important dans le schéma de la «désinformatsiya», dont ils sont les parfaits véhicules porteurs. Cela est surtout vrai pour les satellites polonais, est -allemand et tchèque.
La désinformation émanant du K.G.B. développe en permanence une autre activité aussi systématique que sournoise, celle des dénommés «agents d’influence», dont les répercussions sont à la longue bien plus qu’inquiétantes.
La mission des «agents d’influence» consiste à créer dans les milieux où ils se trouvent une atmosphère favorable aux intérêts de l’Union Soviétique. Et, en fait, ils développent cette action dans les milieux les plus différents, depuis les syndicats jusqu’aux cercles intellectuels et artistiques, depuis les organes de la presse jusqu’aux gouvernements eux-mêmes.
Pour bien comprendre comment se met en place puis s’articule un service de «désinformation» à l’intérieur d’un pays, lisons le témoignage tout à fait exceptionnel d’un haut fonctionnaire polonais, spécialiste des services spéciaux de son pays, qui s’est réfugié à l’Ouest. Selon lui, les Polonais comptent actuellement parmi les meilleurs spécialistes de la «désinformation». «L’Eglise polonaise», trop puissante au gré des dirigeants communistes, était évidemment l’une des principales cibles de la «désinformation».
Grâce au fichier très complet que l’on a de tous les prêtres, on monte des provocations, envois de lettres anonymes, création de revues catholiques, contenant de violentes charges contre le primat de la Pologne, attribués à des prêtres contestataires, alors que les seuls et authentiques rédacteurs des publications sont des spécialistes en «désinformation».
Source : La manipulation